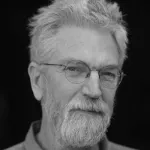Hervé Davodeau
Membres ESO du projet
Site/Multisite ESO
Disciplines
Les projets en cours Hervé Davodeau
Autres projets de recherche récents (responsable)
Constitué en 2019, le réseau Critique et Projet de Paysage (CPP) réunit une dizaine d’enseignant.es-chercheur.es engagé.es dans des formations à la conception en paysage, urbanisme et architecture. Ce réseau s’est donné comme mission de faire de la production des espaces publics un objet du débat public en mobilisant la notion du paysage (CPP, 2021). Entendu comme production culturelle, le projet de paysage parce qu’il traduit une articulation étroite entre les habitant·es d’un territoire et leur environnement se situe au cœur des enjeux de la transition socio-écologique. Or, dans un contexte d’urgence face à la crise climatique, écologique et environnementale, comment prendre encore le temps de comprendre, d’analyser et de critiquer les projets de paysage ?
Que critique-t-on lorsque que l’on critique un projet de conception d’espace public ? Les intentions qui se lisent dans les archives du projet, souvent effacées, dispersées, partielles ? Les discours des acteurs de la conception, ceux de la gestion ou encore ceux qui pratiquent le lieu ? La qualité des espaces effectivement produits, souvent assez différents de ceux qui ont été dessinés et mis en œuvre, par le jeu des altérations écologiques et sociales (Delbaere, 2021). Dans le cas des projets de paysage, il semble délicat de séparer le temps de la production du projet de paysage et le temps de son évaluation critique, car le projet de paysage se construit dans une durée longue et ininterrompue, au-delà de l’intervention de la maîtrise d’œuvre (Besse, 2018). L’une des spécificités d’un projet de paysage est qu’il se déploie dans le temps : celui de la maturation des composantes biologiques et abiotiques du lieu, mais aussi celui des usages, des perceptions et des pratiques sociales qui s’y déploient.
Les membres du réseau affirment que la critique de projet de paysage opère toujours sur un objet en train de se faire, Elle participe du processus de conception tel qu’il se poursuit au-delà des opérations de réception des travaux (Delbaere, 2009), notamment via les actions des services gestionnaires, des riverains et de la maîtrise d’usage (Zetlaoui-Leger, Fenker, 2022) et plus largement de l’histoire culturelle des regards et des sensibilités.
Ce que l’on pourrait appeler la réception publique du projet de paysage peut-elle être considérée comme une critique en acte du projet ? C’est ce que nous aimerions ici éclaircir. En cherchant les moyens de mobiliser le discours critique dans une forme verbalisée, en cherchant à installer les conditions du débat à son propos, nous cherchons à mieux interpréter les actes de modification, d’appropriation ou de dégradation qui transforment, dans la durée, le projet initial et lui confèrent sa réalité contemporaine. La critique est entendue ici non comme une stricte évaluation à partir de critères établis a priori, et dont l’application laisserait peu de place à l’interprétation et donc au débat démocratique, mais comme une démarche de lecture, de description et d’analyse d’une œuvre. Cette démarche considère notamment la multiplicité et la complexité de ce qui concourt à sa création : le cadre d’une commande publique, les contraintes budgétaires et techniques, l’imaginaire et l’écriture d’une conceptrice ou d’un concepteur, la façon dont les institutions et la société civile s’emparent du projet et/ou des espaces produits, le contexte géographique, culturel et politique dans lequel la démarche de conception prend place, ainsi que les conditions sociales du jugement de goût qui influencent sa réception par différents publics.