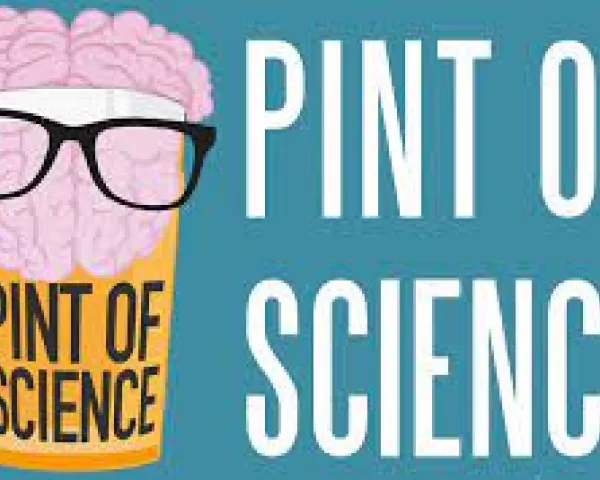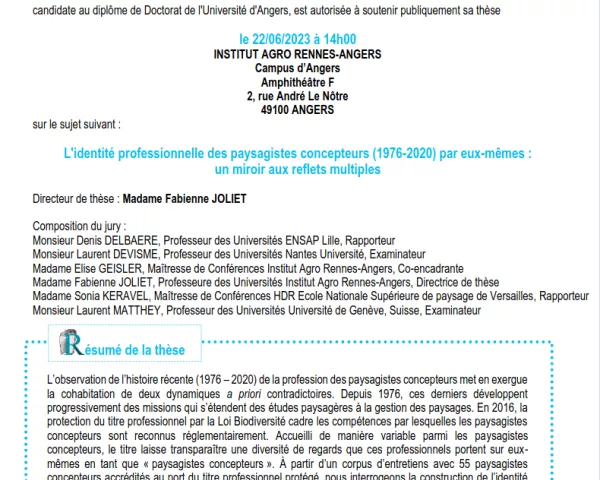De la reconnaissance sensible des lieux aux identités sonores urbaines
I) Cadrage du sujet et question de recherche
I. 1) Cadrage
Le fil conducteur de ce travail de recherche porte sur la manière dont le rapport sensible et affectif participe à la construction de l'identité géographique et sociale des individus, à travers une démarche méthodologique qui implique la participation des habitants autour d’un dispositif de composition sonore. Le sujet s’inscrit pleinement dans l’actualité de la recherche scientifique en urbanisme sur des thématiques telles que la sonorisation des espaces de la ville et le travail de professionnels de l’aménagement et du design sonore.
La dimension sensible et affective prend de plus en plus de place dans les pratiques des urbanistes, qui multiplient les études et les cartographies de la perception des lieux par leurs habitants et leurs usagers pour répondre au plus près à leurs besoins. Cette percée de la question des sens et des perceptions chez les acteurs de l’aménagement donne lieu à la fabrication d’ambiances architecturales et urbaines : pensées comme des dispositifs d’aménagement « totaux », puisqu’ils sont censés remodeler la totalité de ce qui fonde l’expérience, la pratique, et le vécu des lieux. Ces actions urbanistiques proposent une nouvelle narration, une mise en récit des lieux, qui s’inscrivent le plus souvent dans des logiques de pouvoir, en lien par exemple avec les phénomènes de gentrification des centres villes notamment (Morovich et Desgrandchamp, 2016).
Ces dispositifs s’inscrivent dans un environnement sonore pré-existant, qui s’exprime dans le cadre des villes occidentales par des sonorités issues de la révolution industrielle : liés à la révolution des transports, à la production industrielle et à la transformation continue de l’habitat et des infrastructures (travaux, chantiers, …), qui fonctionnent comme une nappe de fond où viennent se greffer des sonorités à valeur signalétiques ainsi que des marqueurs sonores (symboles, qui fonctionnent comme des repères situationnels et identitaires : cloches, cris d’animaux emblématiques, sirènes de bateaux, etc.) (Murray Shafer, 2010 [1977]). Cet environnement sonore « banal » est perçu à l’échelle de chaque individu par le prisme de ses pratiques quotidiennes : de ses déplacements dans la ville, des temporalités avec lesquelles il fréquente certains lieux ; mais aussi des affects qu’il éprouve et des émotions qu’il ressent au passage de ces lieux ou à leur souvenir. Lorsqu’il est évoqué en contexte d’entretien, cet environnement sonore révèle une autre narration (affective), une mise en récit des lieux plus intime, individuelle ou partagée, qui relève du vécu et des représentations attachées à l’urbain et à l’urbanité.
I. 2) Question de recherche
Notre objectif, au cours de ce doctorat, sera ainsi de répondre à la question de recherche suivante : En quoi l’expérience musicale et le rapport affectif au lieu contribuent à la construction de l’identité spatiale des lieux et des individus ?
II) Positionnement conceptuel
II. 1) Contexte scientifique
Le visuel a longtemps été « souverain » dans les sciences humaines et sociales, en psychologie comme dans l’approche paysagère en géographie (Augoyard, 1994). Ce primat de la perception accordé au monde visueltrouve sans doute sa source dans la capacité du cerveau humain à traiter plus rapidement l’information qui nous arrive de l’œil que celle qui nous arrive de l’oreille. Le sonore est donc toujours vécu comme une confirmation, une résonnance qui découle de l’image, en étant analysé en second, comme caractéristique de l’événement perçu. Et pourtant le sonore est essentiel, car ce qui est en jeu, c’est toute la qualité de ce qui est vu. Le son est « la chair des images, [leur] matière, [leur] matérialité, [leur] plasticité, [leur] flux, [leur] vitesse, [leur] densité, tout ce qui caractérise le vivant. » (Deshays, 2015).
L’environnement sonore fait ainsi partie intégrante de l’identité d’un lieu (Murray Shafer, 2010 [1977]) et les bruits ambiants sont des témoins privilégiés des pratiques quotidiennes et des repères singuliers du fait d’habiter la ville (Delage, 1989). On peut définir un environnement sonore comme la « zone étroite entre surgissements et disparitions » d’objets sonores qui enveloppent les pratiques et les déplacements quotidiens au sein de l’espace terrestre occupé par chaque individu, tout en pouvant être en partie produits par eux (Deshays, 2015).Le geste d’écouter cet environnement sonore provoque un phénomène « d’oblitération sélective » qui permet à certains sons de s’imprimer dans la mémoire, en fonction du vécu et des affects de chacun (Marry, 2013 ; Torchin, 2016).
S’intéresser au vécu des espaces urbains par le prisme des perceptions sonores, c’est donc s’intéresser au croisement de deux expériences sur un espace donné : une expérience (multi)sensorielle et une expérience affective. Cette expérience, ou plutôt ce rapport affectif, désigne de façon très simple toutes les relations intimes qui nous lient aux espaces : que nous aimons, que nous n’aimons pas, ou qui nous sont indifférents. Pour Denis Martouzet c’est le rapport à l’espace en tant qu’il met en jeu la personne : par la production d’émotions, de reconnaissance, d’estime de soi, voire d’identification en construisant une relation durable, de type sentimentale (Martouzet, 2014, 2013, 2007; Feildel, 2013, 2010).
II. 2) Ambiances sonores et musicalité des lieux : pour une étude du rapport affectif des espaces urbains
Au cours notre Master 2 en géographie-aménagement, qui a été pensé comme la première étape d’un travail de thèse, nous avons mené une enquête qui nous a conduit à élaborer une grille de qualification acoustique de neuf ambiances sonores enregistrées dans l’espace urbain caennais. En croisant ces grilles aux évaluations affectives des ambiances correspondantes, nous avons montré que la dimension « musicale » ou « amusicale » d’une ambiance sonore pouvait être un moyen pour les personnes interrogées d’évoquer les émotions ressenties à leur écoute. Ils semblent que les personnes enquêtées entendent derrière le terme de musicalité un certain équilibre des signaux sonores perçus (l’absence de cacophonie, de bruits considérés comme agressifs ou la netteté du signal sonore) mais également l’émergence d’émotions, de souvenirs, d’associations à d’autres ambiances vécues en d’autres lieux. Il a été noté, enfin, que se sont le plus souvent les ambiances jugées les plus musicales, qui sont les mieux aimés, tout en correspondant également aux lieux les plus aimés : ce qui tend à montrer l’existence d’un lien entre la dimension esthétique accordée à un espace et le rapport affectif existant vis-à-vis de ce dernier.
Notre question de recherche pose donc que ces deux notions : musicalité et rapport affectif, en se combinant, participent à la construction de l’identité sonore des lieux et des individus en s’exprimant par des discours comme un reflet de l’identité spatiale en générale de ces derniers (Relph, 1986 [1976] ; Stock, 2006). L’affirmation d’une singularité sonore d’un lieu, mise en tension avec sa ressemblance avec d’autres lieux connus ou imaginés forment ainsi un référent géographique sensible, en partie personnel, mais qui relève également d’une construction sociale et culturelle.
III) Hypothèses de recherche et terrains
III. 1) Hypothèses de recherche
1°) Hypothèse affective/Géographie sensible :
La musicalité d’une ambiance sonore est révélatrice de la relation affective à l’espace, par les ressentis et les émotions qu’elle procure.
2°) Hypothèse cognitive/Géographie des représentations :
La musicalité est un marqueur des identités spatiales.
III. 2) Terrains d’étude
Trois villes ont été choisies pour valider ces hypothèses : Caen, Rennes et Tours, ce périmètre pouvant être amené à s’étendre à d’autres villes, en lien avec des projets de mise en valeur sonore qui pourraient y être mis en œuvre. Ces trois villes offrent des profils comparables en termes de population et de fonctions urbaines: ce sont trois villes moyennes, et de rayonnement régional ou infra-régional, bien que leurs identités urbaines se différencient. Rennes présente l’image d’une ville métropolitaine en construction, Caen l’image d’une ville littorale reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, et Tours l’image d’une ville au bâti ancien patrimonialisé. La question de leur identité sonore, semblable et différente à la fois, peut donc se poser avec d’autant d’acuité.
Le but de ce travail de recherche n’est donc pas de travailler sur des hauts-lieux mais plutôt des espaces vécus relevant du quotidien des habitants. En ce qui concerne la méthodologie, nous envisageons un dispositif qui privilégie l’entrée individuelle mais qui ouvre sur une démarche collective.
IV) Méthodologie
IV. 1) Première étape : l’échelle des pratiques individuelles
En nous basant sur une méthode expérimentée au cours de notre Master 2, il s’agira dans un premier temps de demander aux individus volontaires qui résident ou qui fréquentent les lieux sélectionnés d’aller enregistrer l’ambiance sonore des lieux qu’ils pratiquent, pour lesquels ils éprouvent des émotions, un attachement particulier. Ce dispositif nécessite le prêt d’un enregistreur sonore performant et maniable, offrant une bonne qualité d’enregistrement et surtout permettant de rendre compte de la spatialisation des signaux sonores. L’objectif de cette première étape est de mettre en évidence des lieux et des moments où les gens se sentent bien, dans leur quartier mais aussi dans le reste de leur ville, avec une liberté maximale, sans la présence de l’enquêteur. Cette méthode offre l’intérêt d’une couverture spatiale plus importante que la promenade commentée (puisqu’alors on risque de ne se situer que dans les limites du quartier ou ses abords immédiats).
IV. 2) Deuxième étape : l’échelle des rapports individuels au quartier et à ville
Une série d’entretien basée sur la méthode des « entretiens sur écoute réactivée » c’est-à-dire à partir des enregistrements sonores des lieux choisis par les participants (éventuellement complétés par d’autres sons enregistrés nous à partir d’observations de terrains) de réaliser des entretiens individuel et collectifs semi-directifs longs et approfondis (Augoyard, 2001).
L’objectif de cette deuxième étape est de faire émerger des représentations associées à leur vécu personnel : en quoi ces lieux et ces ambiances résonnent en eux ? Quelle place représentent ces endroits dans leurs pratiques spatiales? A quels autres lieux vécus dans le passé, désirés, imaginés, cela les renvoient-ils ? C’est une approche qualitative, qui a pour objectif de réveiller le vécu sonore des participants pour qu’il puisse être évoqué.
IV. 3) Troisième étape : l’échelle des rapports collectifs à la ville
Il s’agira de réunir les participants des trois lieux choisis dans une seule pièce et les faire réaliser une carte sonore de leur ville en recomposant son identité sonore. Deux techniques sont donc combinées ici : la carte sonore et le générateur d’ambiance sonore créé par Philippe Woloszyn, chercheur CNRS (Marry, 2011 ; Woloszyn, 2012).
L’objectif de cette dernière étape est d’interroger l’identité sonore de la ville auprès des différents groupes sociaux, et donc l’identité de la ville en général, en tant que phénomène vécu, comme un processus d’expériences sensibles en lien avec la mémoire des lieux et l’appropriation des usagers de la ville.
L’analyse du matériau narratif et descriptif récoltéreposera sur les proximités entre éléments d’ordre affectifs et ceux relatifs à la musicalité par une méthode d’analyse de contenu dans les expressions, les discours, les réactions, et les interactions entre les participants.
V) Encadrement et environnement institutionnel
Concernant l’encadrement de ce travail thèse, notre directeur de recherche à l’Université Rennes 2 sera Benoît Feildel, Maître de conférence, membre de l’UMR ESO et Denis Martouzet, Professeur à l’Université François Rabelais de Tours, membre de l’UMR CITERES.
Ce projet de recherche a pour objectif de s’inscrire dans l’axe 2 du projet scientifique de l’UMR ESO dont l’objet est d’interroger le rapport des individus et des groupes sociaux à l’espace afin d’apprécier en quoi et comment les parcours et les trajectoires de vie, les dispositions sociales mais aussi les sensibilités individuelles et collectives influencent voire structurent nos pratiques de l’espaces et nos représentations.
Ce sujet fait de plus écho au Groupement de Recherche International MIAMI qui inclut des anthropologues, des ethnomusicologues et des géographes de différentes institutions ; ainsi qu’aux recherches déjà menées sur le sonore au sein de l’UMR ESO, comme en témoigne l’ouvrage collectif Soundspaces : Espaces, expériences et politiques du sonore, publié aux PUR en 2014.
VI) Bibliographie
VI. 1) Ouvrages et articles scientifiques
- AUGOYARD J.-F., 2001, « L'entretien sur écoute réactivée », in GROSJEAN M., THIBAUD J.-P. (dir.) L'espace urbain en méthodes, Marseille, Editions Parenthèses, 2001, pp.127-153
- DELAGE B., 1989, Paysage sonore urbain, Éditions Plan construction
- FEILDEL B., 2013, « Vers un urbanisme affectif. Pour une prise en compte de la dimension sensible en aménagement et en urbanisme », Norois, 2/2013, n° 227, p. 55-68
- FEILDEL B., 2010, Espaces et projets à l'épreuve des affects. Pour une reconnaissance de rapport affectif à l'espace dans les pratiques d'aménagement et d'urbanisme, Thèse de doctorat, Université François Rabelais, Tours
- GUIU C., FABUREL G., MERVANT-ROUX M.-M., TORGUE H., WOLOSZYN P. (dir.), 2014, Soundspaces : Espaces, expériences et politiques du sonore, Rennes, PUR
- MARRY S., 2013, L'espace sonore en milieu urbain, Thèse de doctorat, Rennes, PUR
- MARTOUZET D. (dir.), 2014, Ville aimable, Tours, PUFR.
- MARTOUZET D. (dir.), 2013, Revue Norois, « Sentir et ressentir la ville », Presses universitaires de Rennes, n°227, 2013/2
- MARTOUZET D., 2007, « Le rapport affectif à la ville : positionnement théorique et épistémologique », Praxis, Revue électronique d’Aménagement
- MOROVICH B., DESGRANDCHAMP P., « Créations sonores et émotions : une géographie strasbourgeoise », Carnets de Géographes, n°9, juin 2016
- MURRAY SHAFER R., 2010, Le paysage sonore. Le monde comme musique, Paris, Wildproject [1e éd. 1977]
- RELPH E., 1986, Place and Placelessness, Londres, Pion, [1ère éd. 1976]
- STOCK M., 2006, « Construire l’identité par la pratique des lieux », in DE BIASE et ALESSANDRO Cr., ”Chez nous ”. Territoires et identités dans les mondes contemporains, Editions de la Villette, pp.142-159
- TORCHIN J., 2016, « Sonate en Ville majeure. Architectural SonarWorks : idéation urbaine pour piano », Cartes & Géomatique, Sept.-Déc. 2016, n°229-230, pp. 175-185
- TORCHIN J., 2016, Aimables ambiances : les ambiances sonores caennaises au prisme du rapport affectif, Mémoire de M2 DYATER, dir. FEILDEL B. et MARTOUZET D., Université Rennes 2
- WOLOSZYN P., 2012, « Du paysage sonore aux sonotopes. Territorialisation du sonore et construction identitaire d'un quartier d'habitat social », in PECQUEUX A. (dir.), Communications, n° 90, Les bruits de la ville, pp. 53-62.
VI. 2) Communications (colloques, entretiens)
- DESHAYS D., 2015, Les chemins de la philosophie, entretien avec VAN REETH A., France Culture, 02/07/2015, 52 min
- MARRY S., 2011, « Des cartes mentales aux cartes mentales sonores: vers une cartographie...